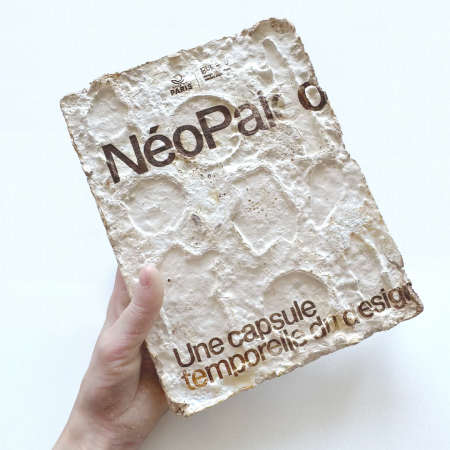Véronique Maire, commissaire et scénographe d’Horizon
Designer et chercheuse, Véronique Maire développe depuis ses débuts une pratique attentive aux savoir-faire et aux matériaux. Après avoir collaboré avec le studio Andrée Putman, elle fonde en 2006 son propre bureau de création, avant de lancer mamama, sa marque d’objets de table. Son travail, nourri par une réflexion sur la production et la matérialité, s’étend aujourd’hui à la recherche au sein de la chaire IDIS (Industrie, Design et Innovation Sociale) qu’elle dirige à l’ESAD de Reims. Ses études sur les filières d’écomatériaux et la dimension sociale du design ont donné lieu à plusieurs publications de référence. C’est dans cette continuité qu’elle assure le commissariat et la scénographie de l’exposition Horizon – expériences de la matière, présentée au JAD du 22 octobre 2025 au 18 janvier 2026.
Véronique Maire, vous êtes designer, enseignante, scénographe, etc. De nombreuses casquettes à votre actif. Pourriez-vous revenir sur votre parcours ?
Je suis designer objet de formation. J’ai commencé mon parcours professionnel chez Andrée Putman, dans le bureau de design qui était dédié au développement produit. Ce qui a été formateur à ce moment-là, c’est l’approche éclectique d’Andrée et la liberté qu’elle nous laissait en termes d’expression et de créativité. C’est très enrichissant d’être stimulée de cette manière en début de carrière.
Depuis 2006, je suis à mon compte. J’ai collaboré avec plusieurs entreprises, notamment autour des arts de la table et des arts du feu : un sujet qui m’intéresse beaucoup. Cela m’a amenée à créer en 2013 ma propre marque d’objets pour la table, mamama. En parallèle, j’enseignais à l’ESAD de Reims, où l’opportunité de monter un laboratoire de recherche en design articulé avec le territoire s’est présentée. Je travaillais déjà avec des entreprises locales, donc je me suis investie dans ce projet. Il s’agissait d’aborder la recherche par la pratique et de renforcer la pédagogie du master design objet. L’idée était de mettre les étudiants au cœur d’un maillage d’acteurs, tels des entreprises, des associations, des institutions et de développer avec eux des propositions de design. Depuis la création de la chaire IDIS, nous avons questionné plusieurs filières des éco-matériaux (lin, chanvre, terre crue, pierre, bois), produit de nombreux prototypes que je valorise par le biais d’expositions, de conférences et de publications.

mamama, sfumato, Le volcan © Lucie Jean

mamama, sfumato, Le lac © Lucie Jean

mamama, sfumato, La montagne © Lucie Jean
Comment en êtes-vous venue au commissariat et à la scénographie ?
La scénographie est arrivée assez vite dans mon activité par le biais de l’événementiel et des salons professionnels. J’ai travaillé avec NellyRodi sur des forums de lingerie, avec 14 Septembre sur la Biennale Émergences, d’abord en tant que scénographe, et depuis 2023 j’assure le commissariat d’exposition avec Helena Ichbiah. Cette année, j’ai également collaboré avec le Bureau du Design, de la Mode et des Métiers d’Art pour l’exposition Fils et Filiations, orchestrée par Audrey Demarre.

BDMMA, Fils et Filiations, 2025 © Matthieu Gauchet

Biennale Emergences, 2025, Studio NATURE CRUE © Lucie Jean

Biennale Emergences, 2025, studio FUTUR ARCHAIQUE © Lucie Jean
Quand vous imaginez une exposition, comment abordez-vous les relations avec les artistes, les œuvres, les publics ? Quel type d’écoute ou d’attention guide votre manière de faire ?
Pour moi, il n’est pas possible de présenter un travail sans connaître la personne qui est derrière. J’ai besoin de cette phase de rencontre, humaine, au sein de l’atelier : voir l’environnement dans lequel le créateur évolue, comprendre les questions qu’il se pose. Cela me permet de montrer le travail au plus juste.
Et puis surtout, le commissariat devient plus intéressant lorsque l’on doit faire dialoguer plusieurs créateurs : cela permet de tisser des liens entre les pratiques tout en rendant plus lisibles les singularités.
Votre polyvalence vous amène à travailler dans des contextes variés, à vous inscrire dans des collectifs – comme c’est le cas avec la Biennale Émergences. Comment cette découverte du JAD se traduit-elle dans l’exposition et comment appréhendez-vous son collectif et sa dynamique de création ?
Je trouve que la synergie se ressent dans l’entente des créateurs entre eux et avec l’équipe du JAD aussi. C’est très significatif au moment des repas du midi, je voyais qu’il y avait une fluidité dans les échanges. Des amitiés se créent. C’est très fort et on se sent tout de suite à l’aise.
Avec les propositions du Programme de Recherche et d’Innovation Collaborative (PRIC), on rentre un peu plus dans la précision des relations entre les créateurs, dans la manière dont leur questionnement et leur savoir-faire se répondent. J’ai constaté aussi que leur enthousiasme réciproque dans ces collaborations pouvait les amener à se surprendre eux-mêmes. Être dans une recherche empirique demande du temps, c’est pourquoi l’exposition présente différentes étapes d’avancement de la création : dessin, échantillon, maquette, prototype fonctionnel, pièce unique.
L’exposition au JAD s’intitule Horizon comment ce mot résonne-t-il avec votre manière de penser l’exposition ? Quelle place avez-vous donnée à la recherche et à l’expérimentation ?
L’exposition s’est vraiment construite autour de cette thématique du paysage et de la matière première. Toutes ces matières naturelles issues des minéraux, des végétaux, étaient très présentes dans les ateliers que j’ai parcourus.
Il y a une manière de s’inscrire dans le monde de demain qui est pertinente, avec un profond respect pour les matériaux, à la fois parce qu’ils coûtent cher mais aussi parce que ce sont des ressources qu’il faut penser dans leur globalité afin de réduire un maximum les chutes, les déchets.
Tout ça était assez récurrent dans les ateliers, mais chacun en parlait d’une manière différente. Ensuite, bien sûr, j’avais envie de faire ressortir ce qui était leur terreau commun. La mise en forme de la scénographie est arrivée assez rapidement, tel un paysage à sillonner permettant de rentrer lentement dans les créations et de comprendre les sources artistiques.
Horizon fait également résonance avec un projet autour du paysage que vous menez avec vos étudiants de l’ESAD de Reims. Comment vos projets personnels et pédagogiques nourrissent-ils votre regard de commissaire ?
Il y a eu un vrai va-et-vient. C’est la première fois que je traite autant du paysage dans un projet de la chaire IDIS. Auparavant, on étudiait un environnement et on parlait plutôt de biodiversité, mais peu de paysage. Le fait d’échanger avec Marie Levoyet et Carole Calvez au cours de la préparation de cette exposition m’a vraiment inspirée. J’ai trouvé intéressant de ramener cette notion assez poétique auprès de mes étudiants.
J’ai récemment organisé une semaine immersive en Belgique, où on a fait beaucoup de promenades afin que les étudiants s’imprègnent des paysages, puis nous avons échangé avec un naturaliste, un paysagiste, les chargés de mission des Parcs naturels régionaux et rencontré des entreprises. L’idée était de comprendre le lien entre paysage, ressources et activités humaines.
Par exemple, les villages sont le reflet des ressources puisées et transformées localement : brique, pierre et ardoise sont très présentes. Auparavant, chaque village avait une briqueterie qui produisait spécifiquement pour le village et c’est tout. Cette proximité de fabrication m’intéresse beaucoup.

ESAD de Reims-chaire idis, projet Transit en Belgique © Véronique Maire

ESAD de Reims-chaire idis, projet Transit en Belgique © Véronique Maire
Est-ce que vous observez une évolution ou une tendance dans les pratiques actuelles des créateurs ?
Je pense qu’il y a aujourd’hui une volonté beaucoup plus forte de ne plus travailler en solo, quelles que soient les générations. Pour les plus jeunes, c’est presque une évidence : collaborer, mutualiser les ateliers, partager les loyers. Cela leur permet de se sentir moins seuls dans la réflexion et d’être dans une dynamique de travail.
Ici, le lieu permet tout ça, avec un accompagnement qui les incite à collaborer. Je trouve que les créateurs du JAD sont vraiment en phase avec ce qui se passe dans la création aujourd’hui.
Et particulièrement au JAD, que retirez-vous de cette immersion dans les ateliers ?
J’observe le projet du JAD depuis qu’il est né. Je le connaissais par le biais des événements hors les murs, mais pas vraiment de l’intérieur des ateliers. Pour moi, ça a été un vrai enrichissement d’accéder à ce lieu, de comprendre comment le projet a été construit et quelles en sont les ambitions.
J’aurais beaucoup aimé avoir accès à ce type de lieu lorsque j’ai démarré mon activité, mais cela n’existait pas. Je trouve que c’est un contexte incroyable et une vraie opportunité pour des créateurs.
Souhaitez-vous nous parler d’une œuvre de l’exposition ?
Pour moi, ce n’est pas tant la finalité qui m’intéresse mais plutôt les étapes intermédiaires et les process. Certains projets présentés sont en cours de recherche, extrêmement prometteurs, qui peuvent partir dans plein de directions.
Je peux citer l’exemple d’Anne Agbadou-Masson et Luce Couillet : ce sont encore les prémices, mais il y a un potentiel énorme dans le fait de tisser la terre sur un métier à tisser. Et quand je vois que certains créateurs collaborent ensemble depuis maintenant deux voire trois ans — Marion Gouez et Sofia Shazak, par exemple — je me dis que ce sont de belles aventures, des pieds à l’étrier qui permettent de conforter des rencontres et d’approfondir les démarches collectives.
Si vous deviez prolonger l’exposition, qu’est-ce que vous aimeriez continuer à explorer, à raconter ?
On en parlait : c’est peut-être plus la question de dévoiler la recherche, amener une forme de démocratisation dans la compréhension de la création. Comment raconter une recherche à un grand public, montrer comment les métiers se mêlent et comment les outils se déplacent.
L’époque implique de se projeter dans une vision multi-métiers, multi-approches. Collaborer avec quelqu’un peut permettre d’apprendre les premiers gestes qui amèneront à un autre métier, et ainsi de suite. La vie d’un créateur, c’est ça : être une force de rebond par rapport aux rencontres et aux thématiques abordées.
Le grand public n’est pas tellement familier avec l’idée de recherche ou d’expérimentation. On a l’habitude de voir des objets finis. Pourquoi la recherche est-elle importante à observer et à montrer ?
La recherche permet de montrer plein d’états du processus créatif. On aura à la fois des dessins, des maquettes, des échantillons, des prototypes pour valider des principes fonctionnels ou constructifs, mais qui ne sont pas encore des pièces abouties.
C’est intéressant de montrer toutes ces étapes successives pour les créateurs, autour d’un élément fédérateur : la matière naturelle.
Une actualité à partager ?
La prochaine actualité qui me concerne prendra forme d’ici quelques mois : je prépare les dix ans de la Chaire IDIS, une rétrospective des sujets abordés autour des éco-matériaux et qui sera l’événement inaugural du nouveau bâtiment de l’ESAD de Reims. C’est un travail conséquent de synthèse en perspective.
Informations pratiques
Horizon – expériences de la matière
Du mercredi au dimanche de 14h00 à 19h00
Galerie du JAD – 6 grande Rue à Sèvres
Entrée libre et gratuite
Propos recueillis par Clara Chevrier, responsable de la programmation et du développement des publics du JAD
Sur la même thématique
Mathilde Faucard, révéler la forêt par le geste

Véronique Maire, commissaire et scénographe d'Horizon

Le JAD au cœur de Private Choice 2025